
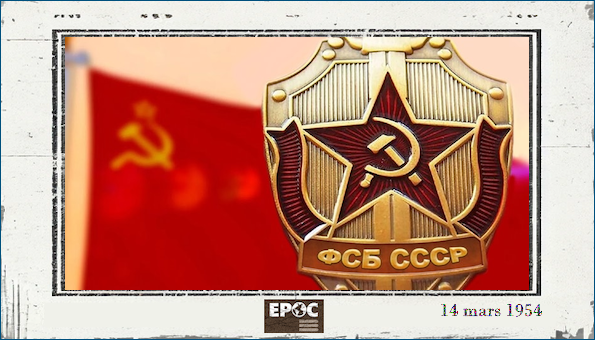
Le 14 mars 1954 marque un tournant dans l'histoire de l'Union soviétique avec la création du KGB (Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti, ou Comité de la sécurité de l'État). Cet organisme de renseignement, qui succède au MGB (Ministère de la sécurité de l'État), devient un pilier central du régime soviétique, intervenant tant dans la surveillance interne que dans les opérations d'espionnage international.
La création du KGB s'inscrit dans un contexte politique complexe, marqué par la mort de Joseph Staline en 1953 et la lutte pour le pouvoir entre ses successeurs, notamment entre Lavrenti Beria, Malenkov et Khrouchtchev. Beria, qui dirigeait le MGB et exerçait un contrôle considérable sur les forces de sécurité, est rapidement évincé et exécuté en décembre 1953, ouvrant la voie à une réorganisation des services de renseignement. Son élimination met fin à la terreur qu'il exerçait sur l'appareil d'État et permet à Khrouchtchev d'affermir son emprise sur le Parti communiste.
Dans ce climat de réorganisation et de prudence, le KGB est conçu comme une entité plus contrôlable et moins susceptible d'agir de manière indépendante, contrairement aux structures antérieures qui avaient acquis un pouvoir autonome considérable. Nikita Khrouchtchev, cherchant à stabiliser le pouvoir et à rétablir une hiérarchie plus stricte, supervise cette restructuration avec l'appui de Malenkov et d'autres figures influentes du parti. L’objectif principal est de limiter l’influence de la police secrète sur la politique intérieure, mais aussi de renforcer les capacités de renseignement international, un élément crucial dans la compétition idéologique et militaire face aux États-Unis et à leurs alliés.
Le KGB hérite ainsi des missions de ses prédécesseurs : répression des dissidents, surveillance des citoyens soviétiques, lutte contre les influences étrangères et promotion des intérêts de l'URSS sur la scène internationale. Il se dote également d'une structure plus centralisée et efficace, avec des départements dédiés à la contre-espionnage, à la collecte de renseignements extérieurs et à la sécurité intérieure. Une attention particulière est portée à la formation des agents et à l'organisation méthodique des opérations de renseignement.
Toutefois, cette réorganisation ne se limite pas à la surveillance passive ; elle s'accompagne d'une intensification des méthodes coercitives. Le KGB utilise la torture, la détention arbitraire et l'intimidation pour briser toute opposition. De nombreux dissidents, intellectuels, artistes et religieux sont arrêtés sous prétexte d'activités antisoviétiques. Certains sont condamnés à de lourdes peines de prison, d'autres disparaissent mystérieusement ou meurent dans des conditions suspectes. Les hôpitaux psychiatriques deviennent des prisons déguisées où les opposants sont internés sous couvert de troubles mentaux, une pratique particulièrement dénoncée par la communauté internationale.
Les purges menées par le KGB ne se limitent pas à l’URSS. Des opposants en exil sont traqués et éliminés, souvent par des moyens sophistiqués, comme l’empoisonnement au ricin ou des attaques déguisées en accidents. Ces réformes garantissent un contrôle renforcé du régime sur tous les aspects de la vie soviétique, consolidant ainsi la domination du Parti communiste et instaurant une surveillance omniprésente de la société, où la peur de la répression devient un élément central du quotidien.
Durant la guerre froide, le KGB devient un acteur majeur du conflit idéologique et stratégique opposant les blocs de l'Est et de l'Ouest. Son réseau d'espions s’étend aux États-Unis, à l’Europe de l’Ouest, mais aussi aux pays du tiers-monde, où il soutient activement les mouvements favorables à l’Union soviétique. Il infiltre les administrations occidentales, plaçant des agents dans les hautes sphères des gouvernements et des services secrets adverses, tout en menant des opérations d’influence et de désinformation massives. Ses agents, souvent recrutés dès l’université ou par idéologie, sont placés dans des postes stratégiques, allant de la CIA au MI6, en passant par l'OTAN et divers gouvernements européens.
Le KGB orchestre également des actions clandestines visant à déstabiliser les régimes hostiles à Moscou, favorisant des coups d’État ou alimentant des conflits par le soutien à des guérillas et des partis communistes locaux. Il participe activement aux guerres par procuration de la guerre froide, armant et formant des groupes insurgés en Afrique, en Amérique latine et en Asie. À travers le monde, il tisse des alliances avec d’autres services de renseignement comme la Stasi en RDA ou le Département V de la Securitate roumaine, renforçant ainsi l’influence soviétique dans le bloc de l’Est et au-delà.
Son influence dépasse la simple collecte d’informations : il façonne activement le cours de la politique internationale, manipulant les opinions publiques par des campagnes de désinformation, finançant des mouvements pacifistes pour affaiblir l’OTAN, et exploitant les fractures internes des démocraties occidentales. Le KGB est à l’origine de nombreuses opérations de sabotage, d’intimidation et d’assassinats ciblés visant des opposants politiques en exil, comme l’empoisonnement de dissidents ou les assassinats commandités à l’étranger.
Son emprise ne se limite pas à l’extérieur : en URSS, il surveille chaque aspect de la société, infiltrant toutes les strates de l’État et maintenant un contrôle absolu sur la population. Les dissidents sont traqués, internés dans des hôpitaux psychiatriques ou envoyés dans les camps du Goulag. Ce maillage mondial et interne fait du KGB un outil indispensable pour maintenir la domination soviétique, tant à l’intérieur qu’à l’étranger, et pour influencer durablement l’équilibre des forces au cours de la guerre froide.
Le KGB existera jusqu'à la dissolution de l'URSS en 1991, laissant un héritage durable dans les structures de renseignement russes contemporaines, notamment avec la création du FSB, son principal successeur. Son rôle dans la politique soviétique et mondiale demeure un sujet d'études et de controverses, témoignant de son importance dans l'histoire du XXe siècle.